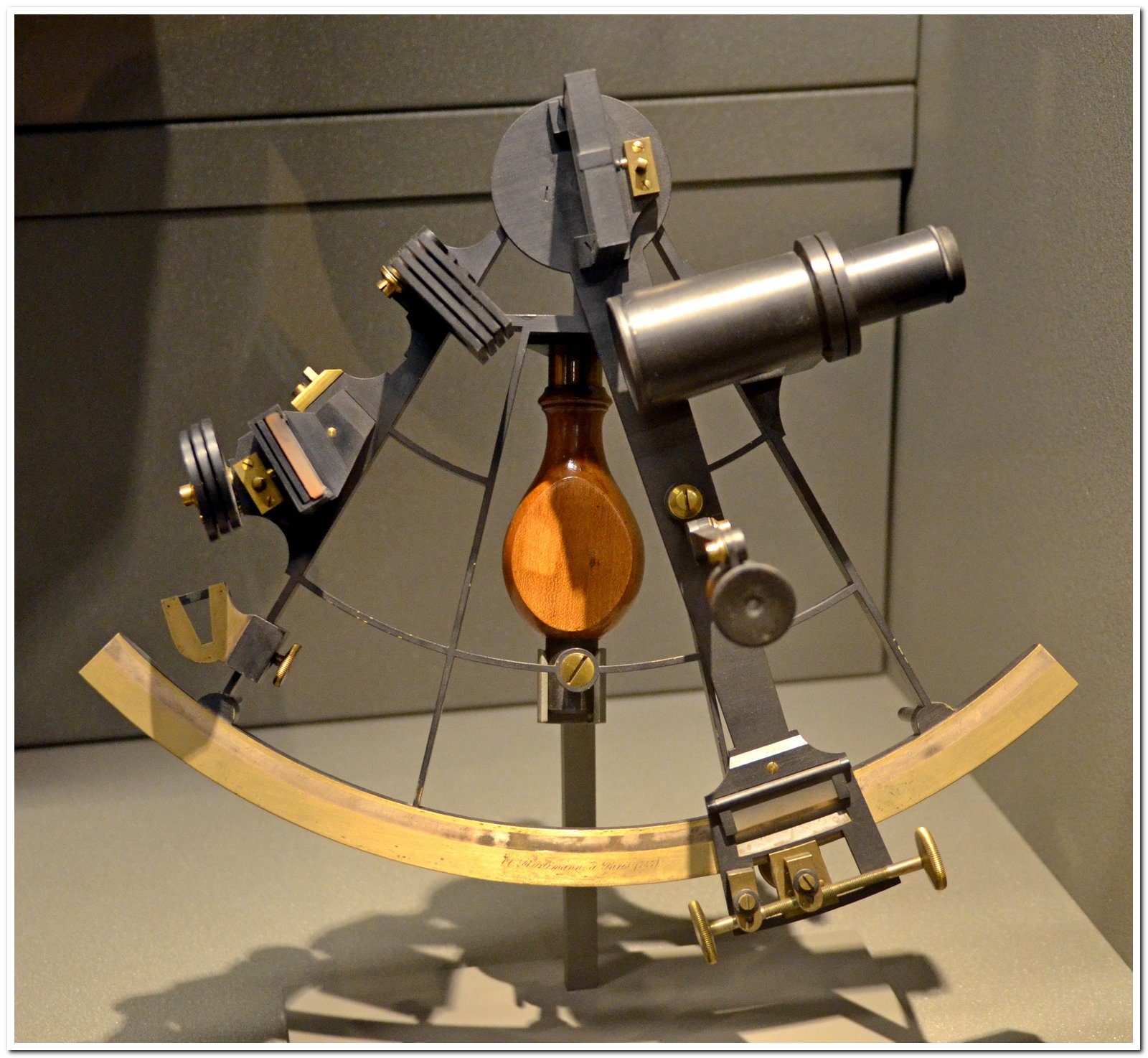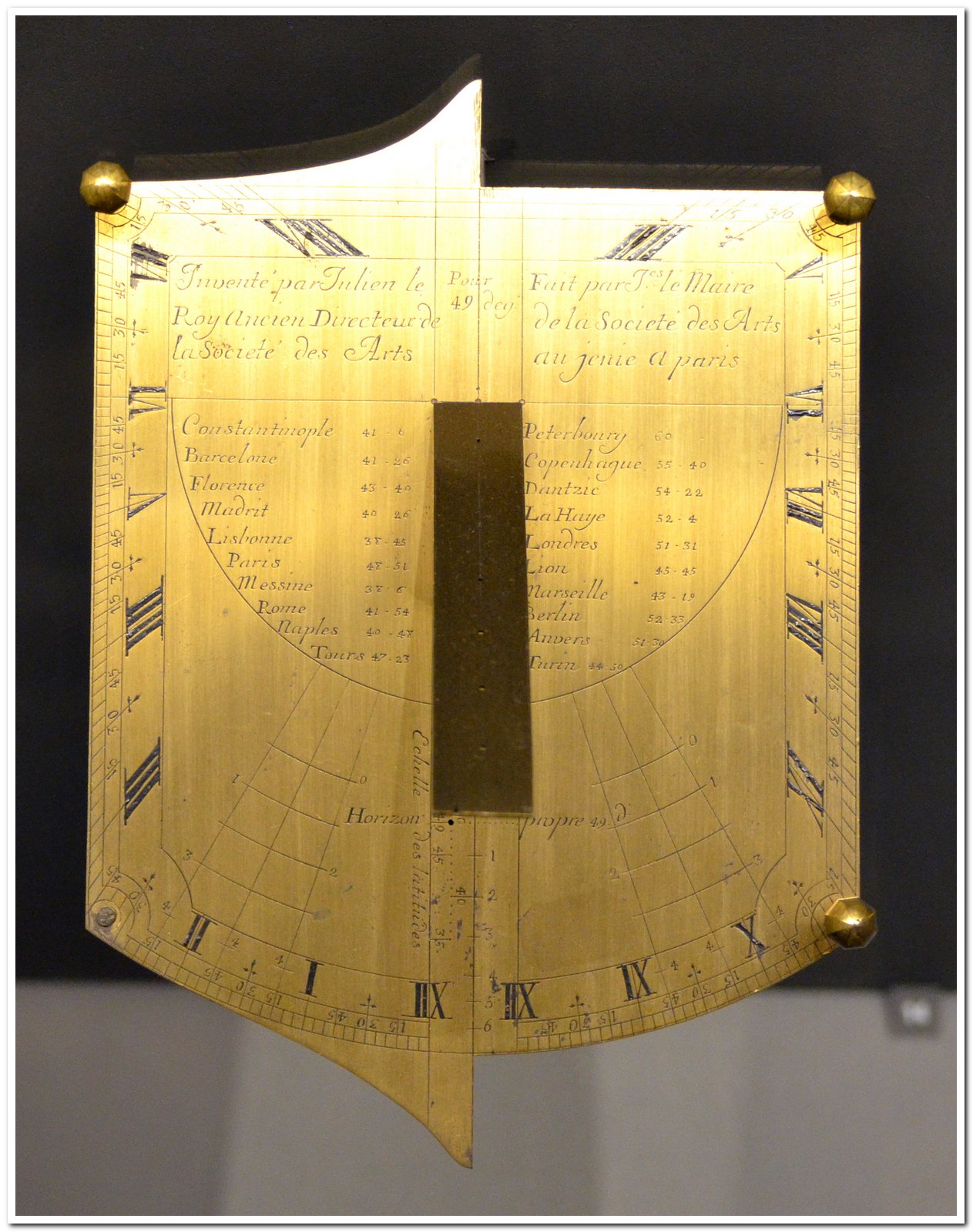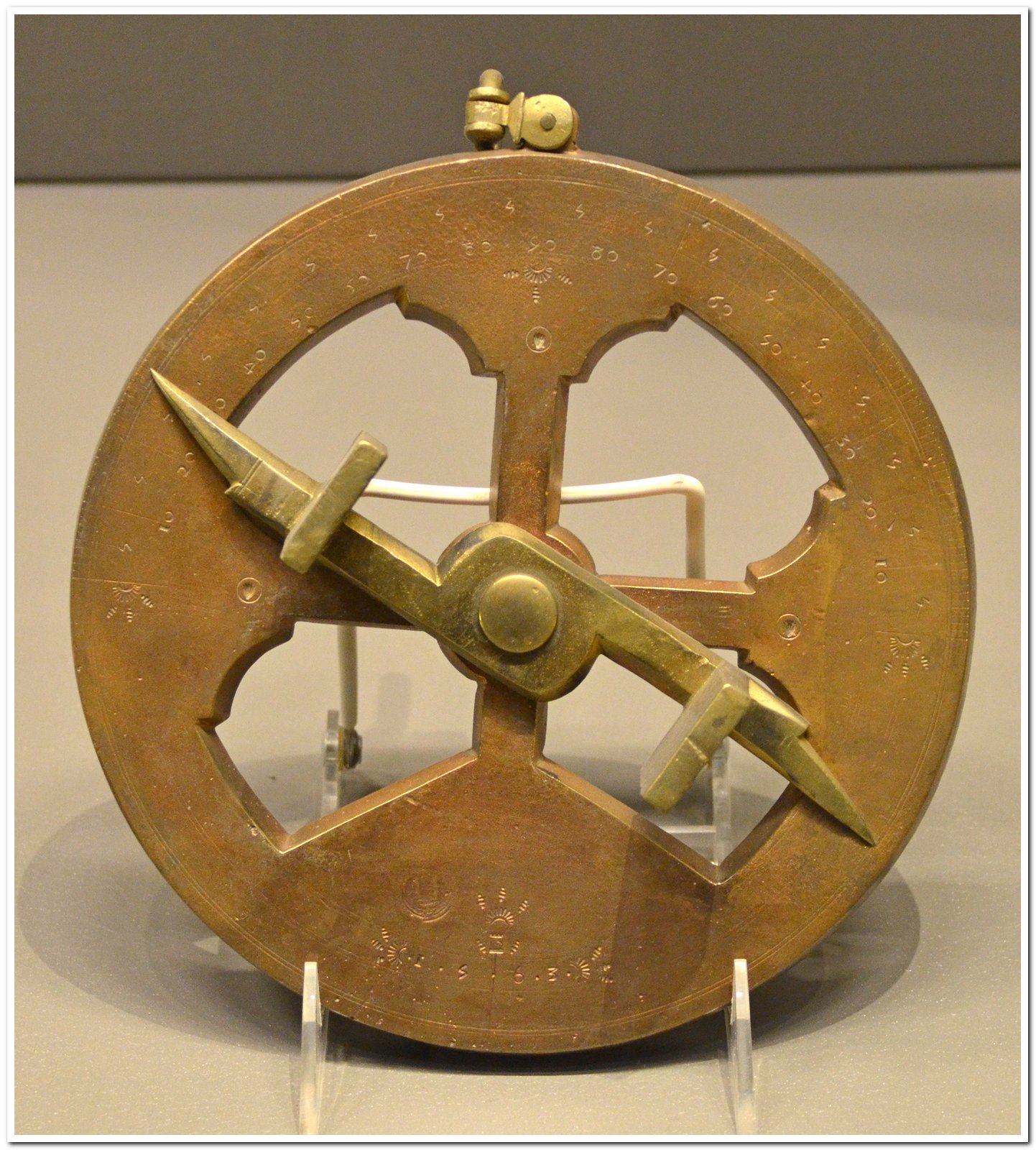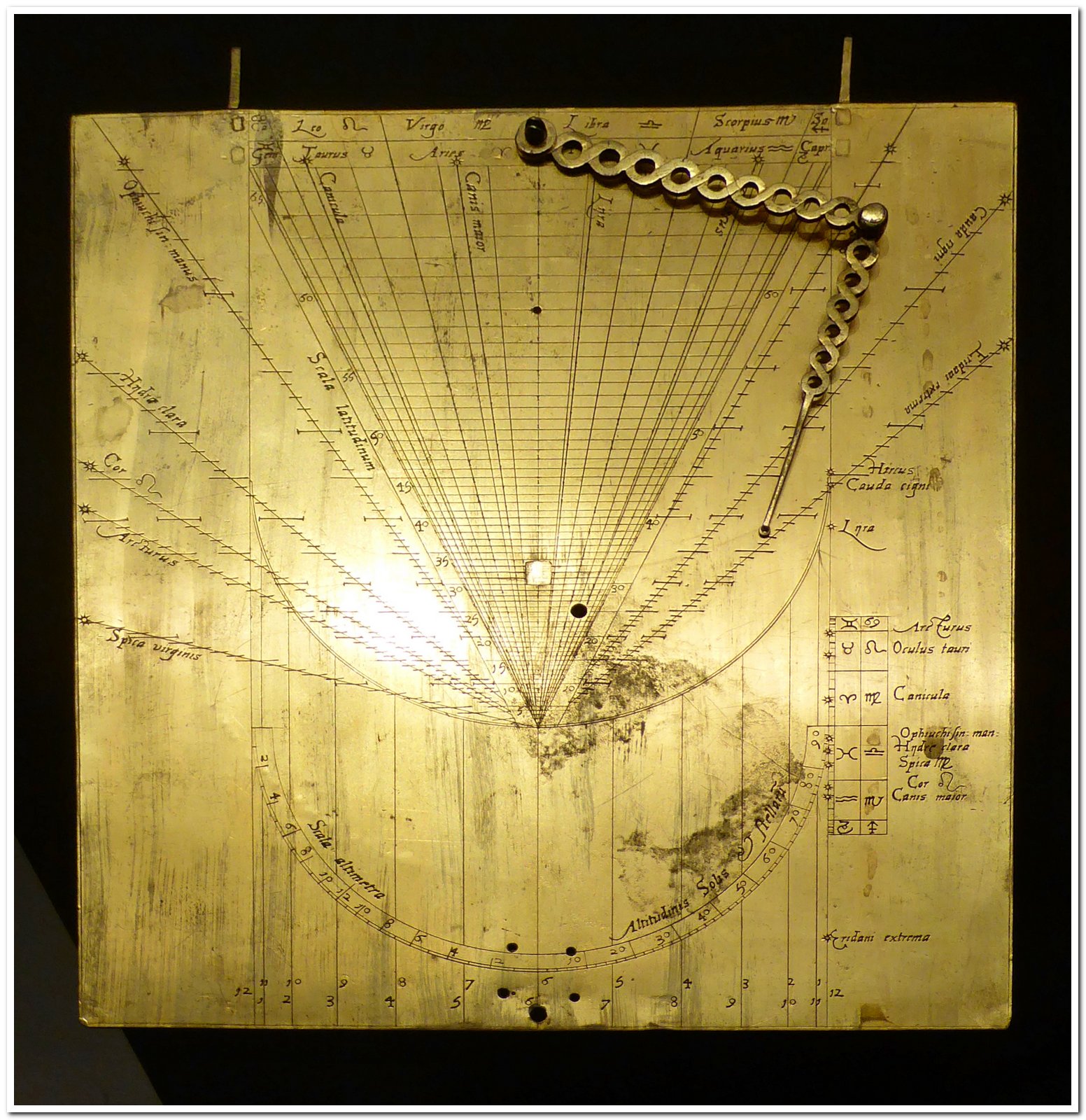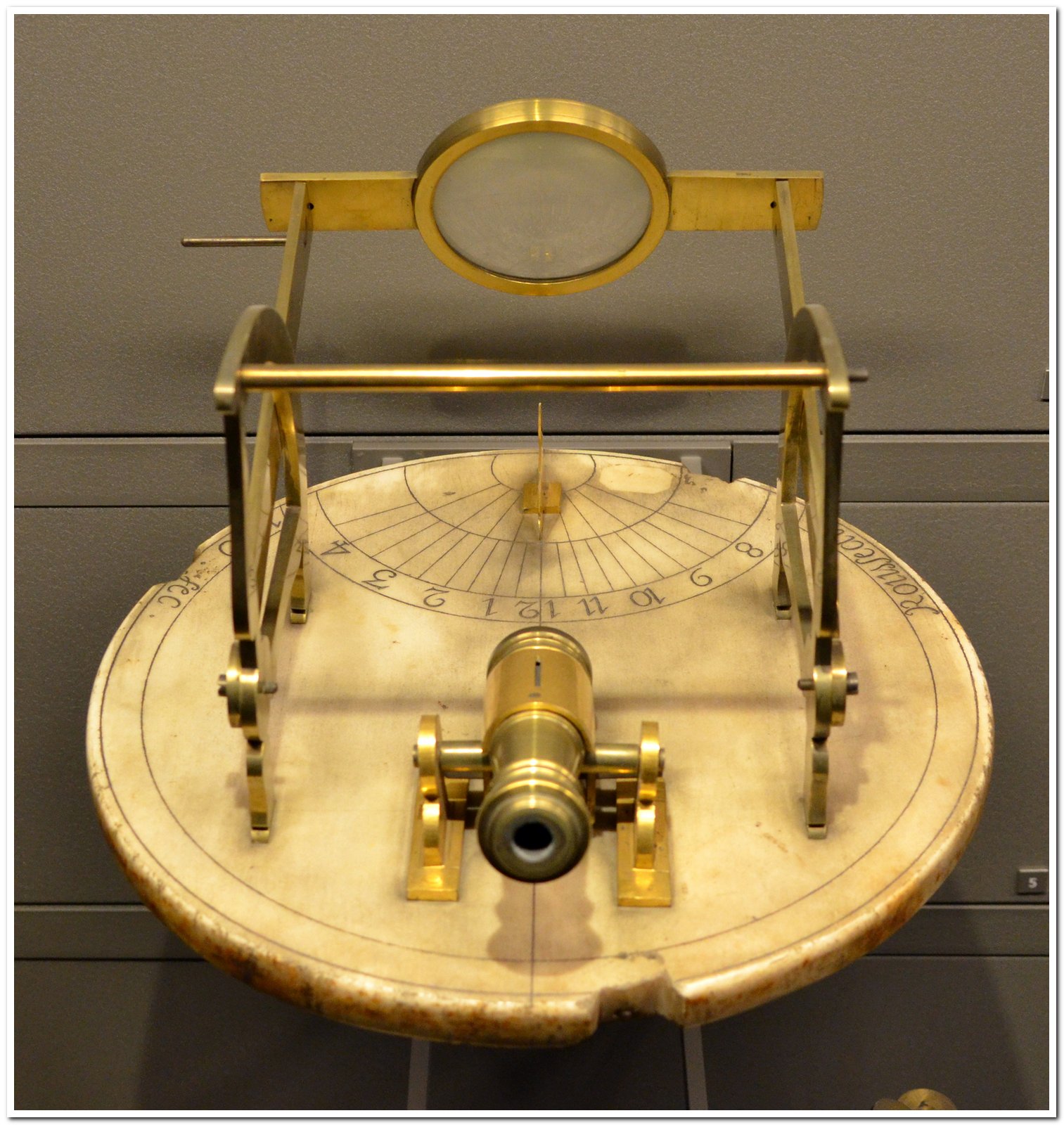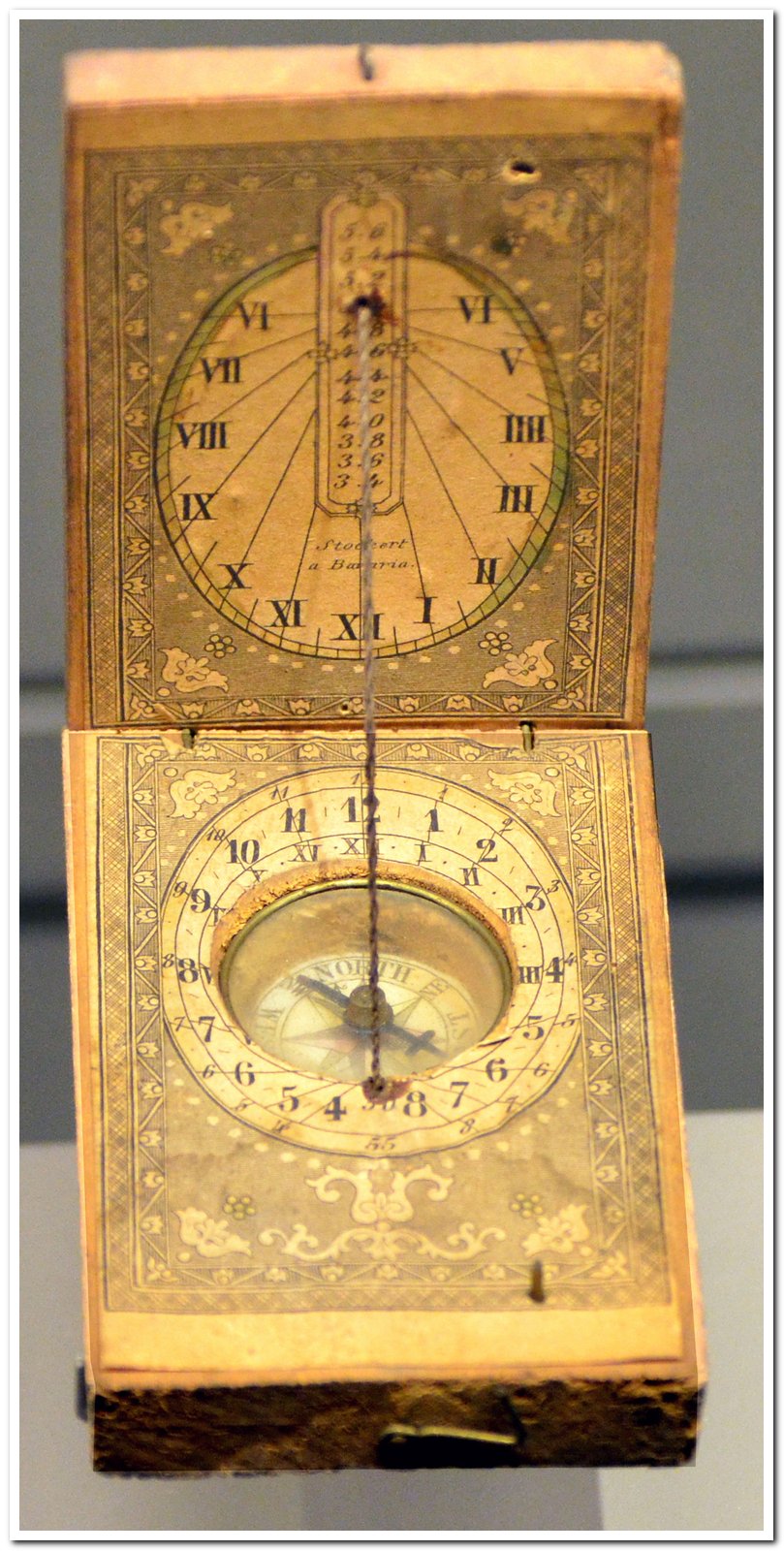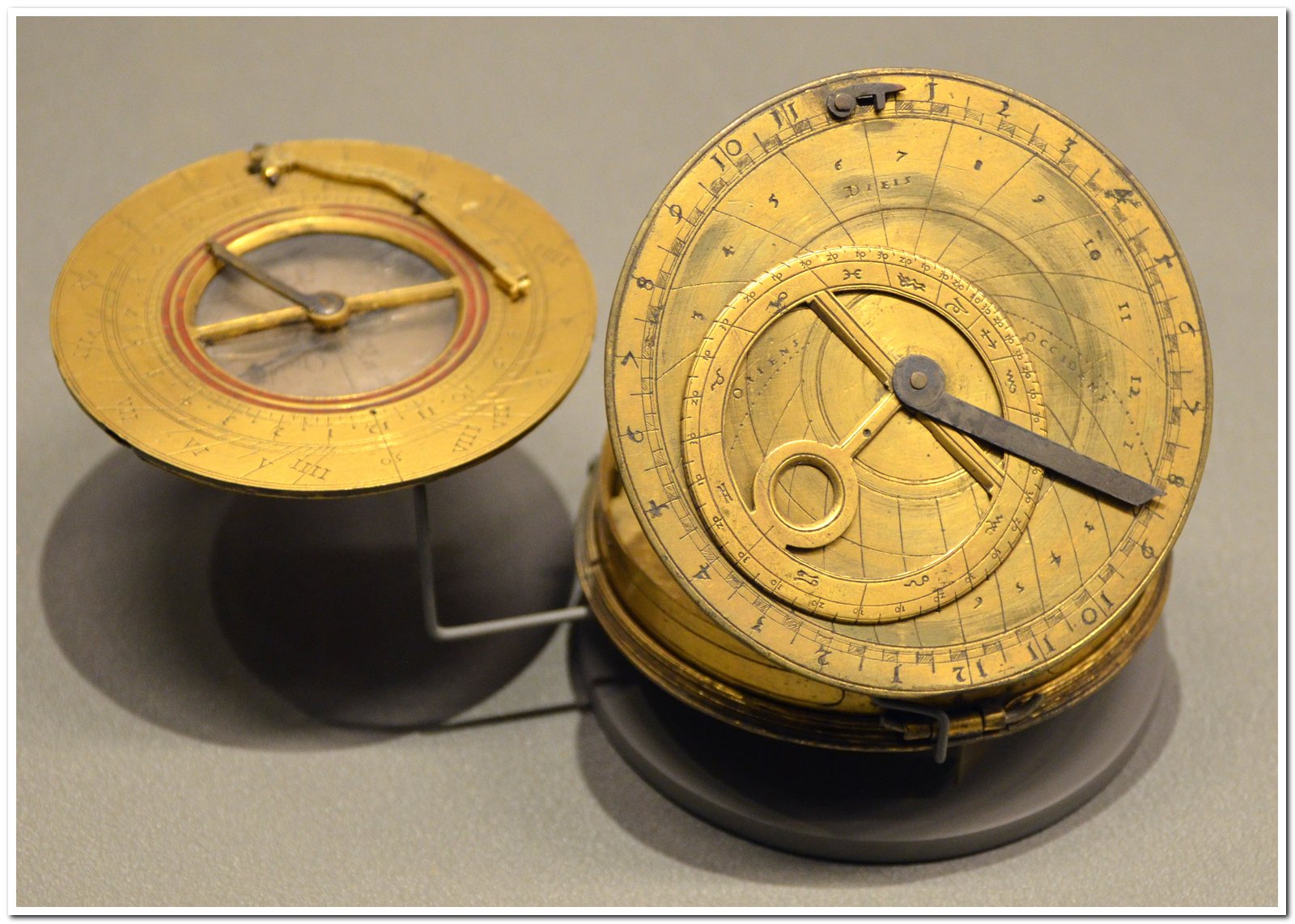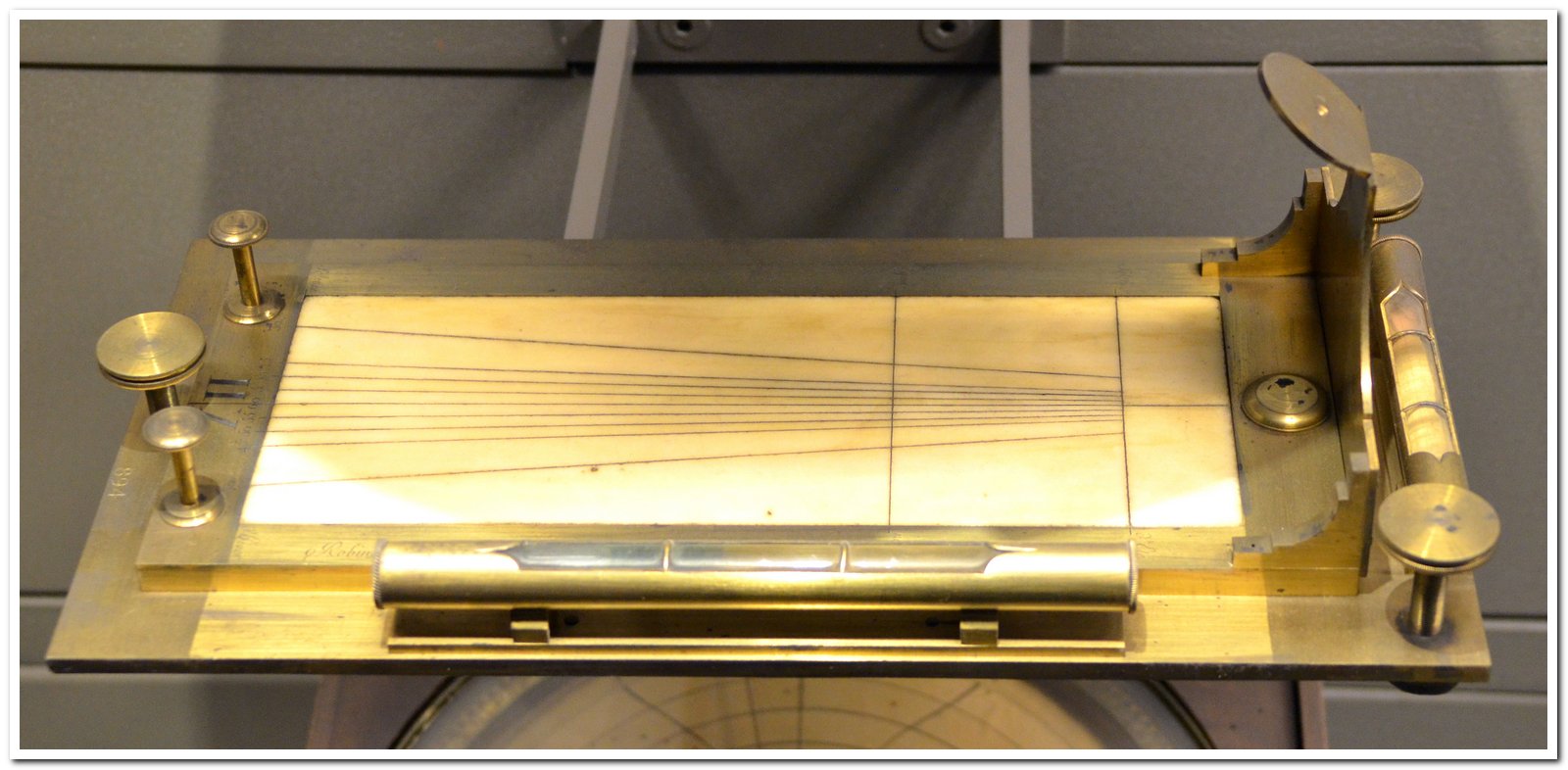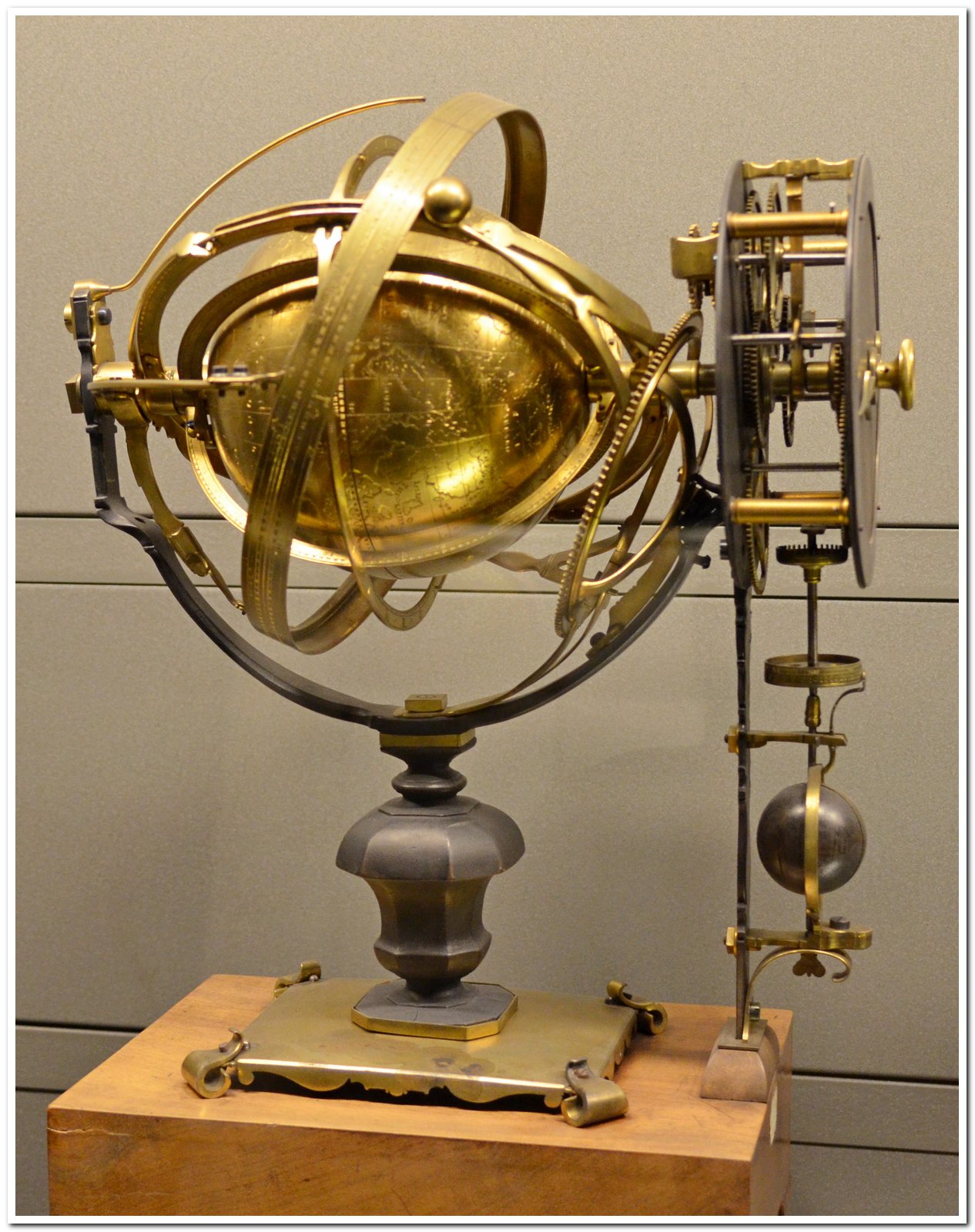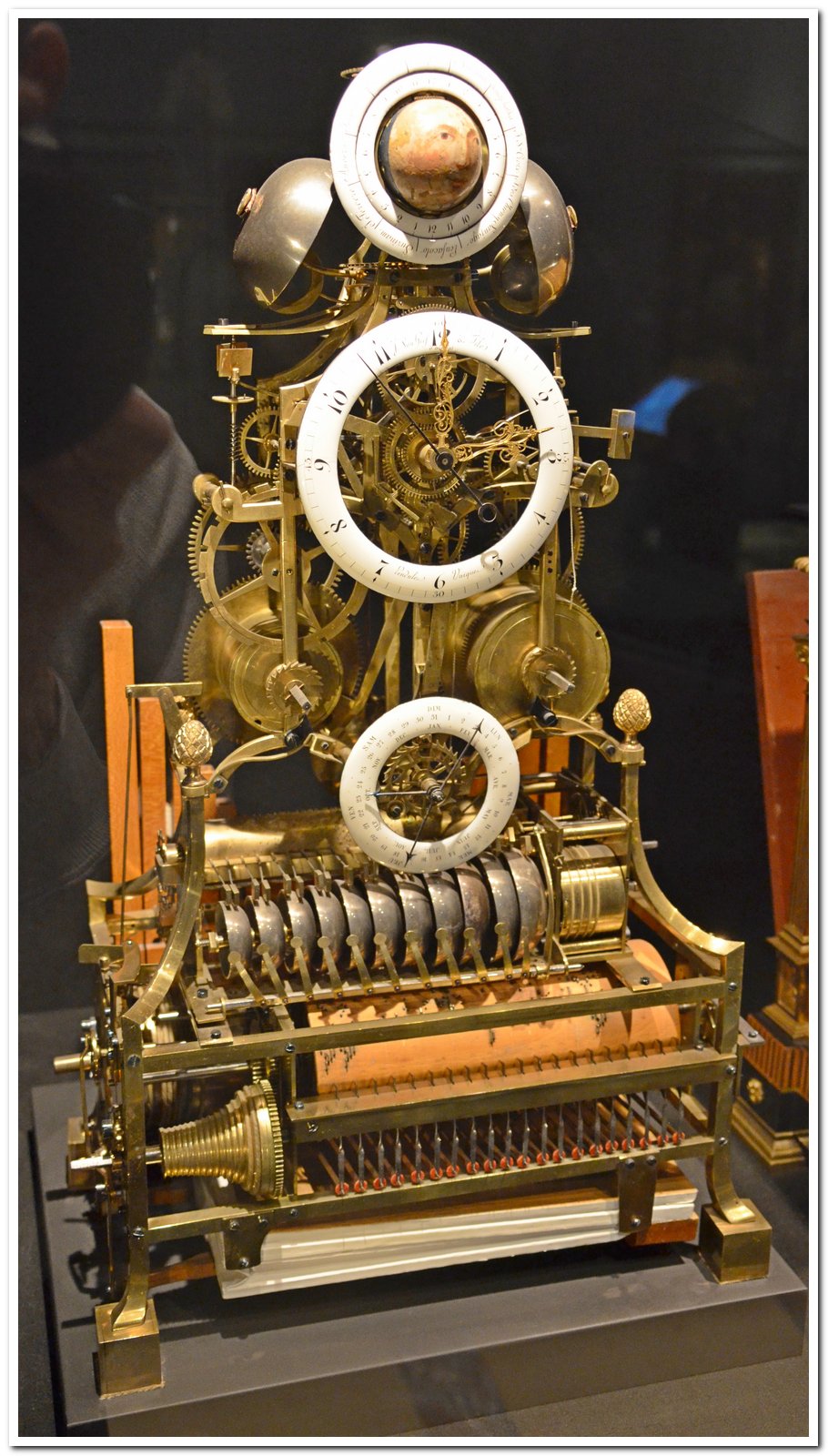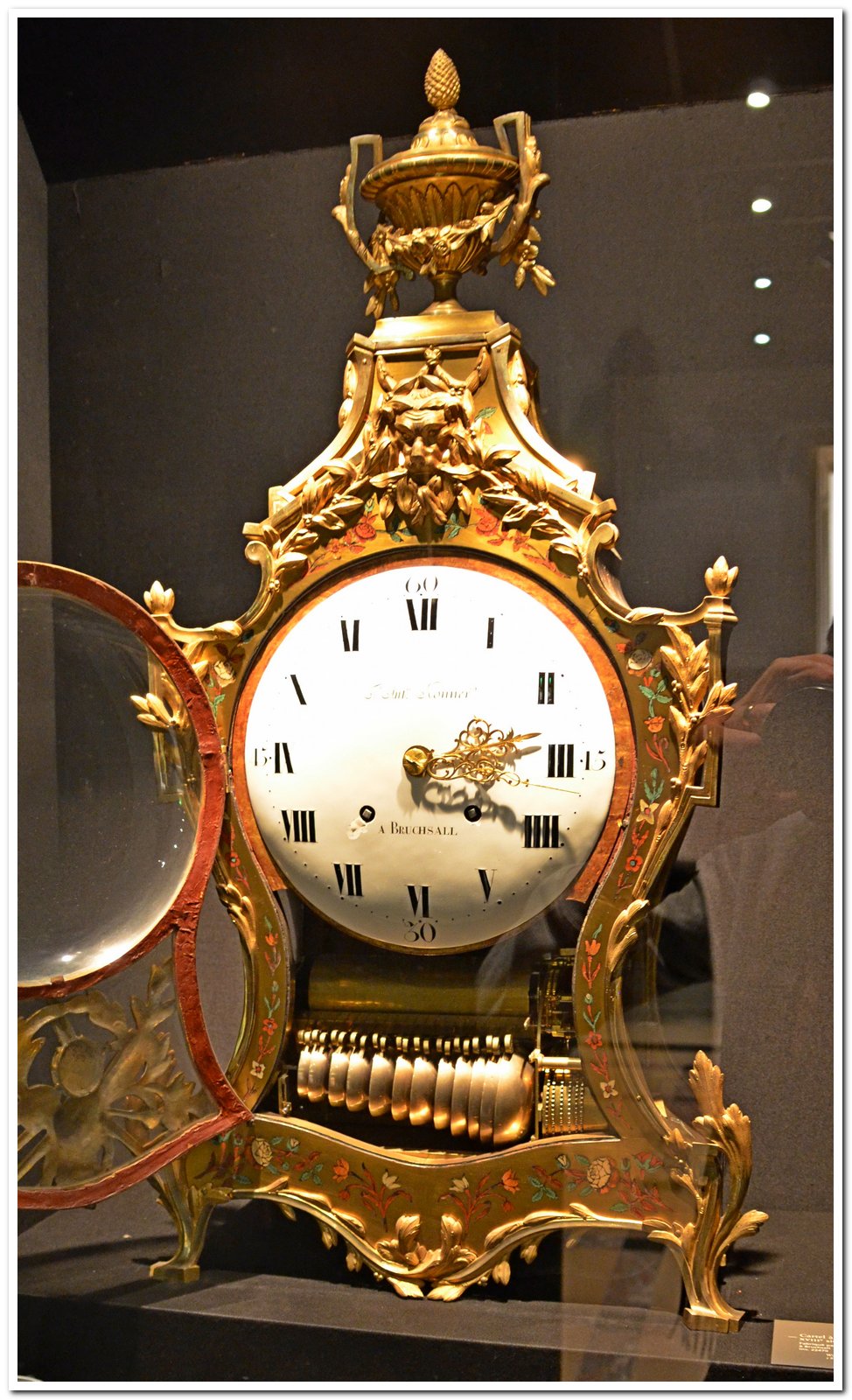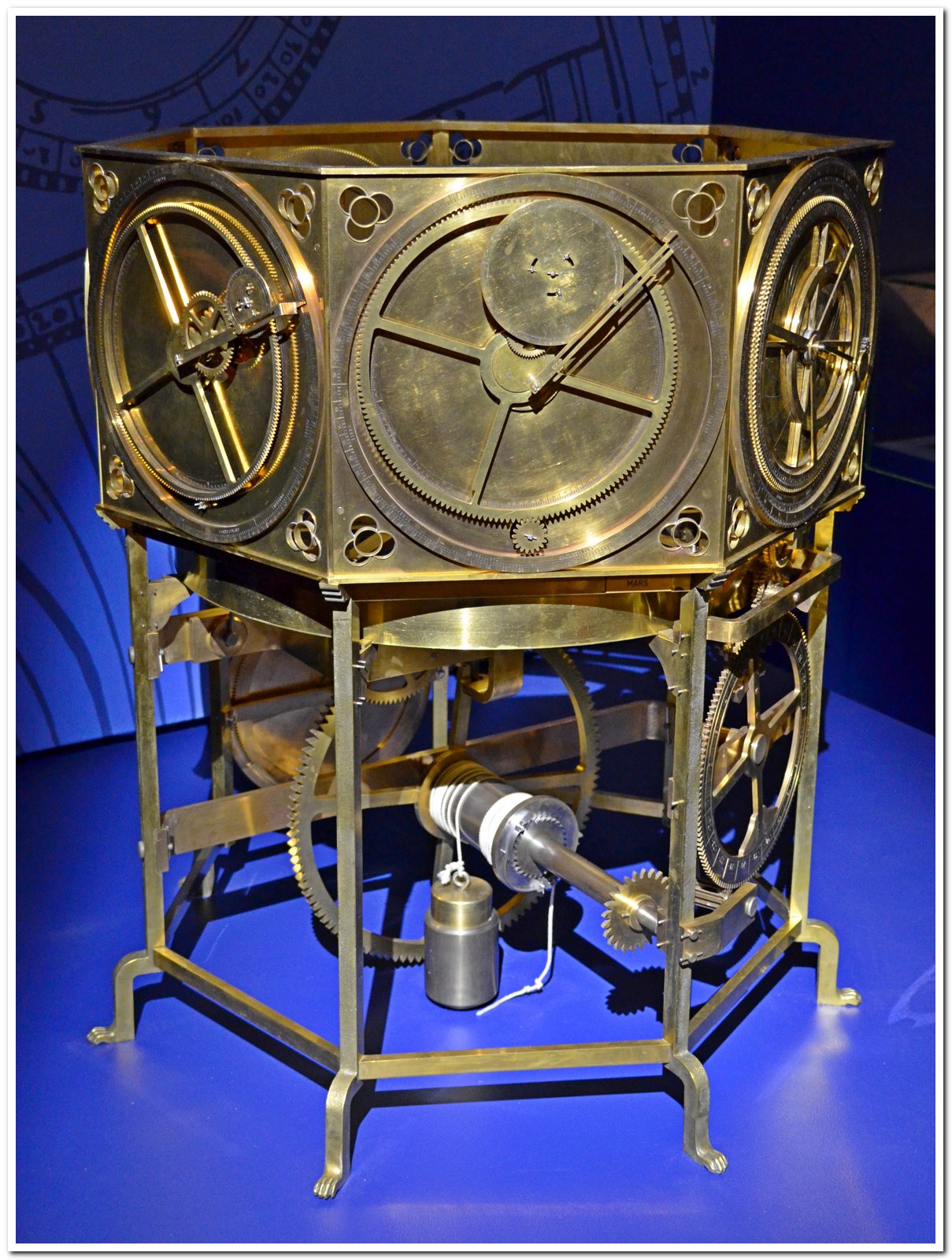|
|
|
Considéré par ses contemporains comme la huitième merveille du
monde, l'astrarium de Giovanni Dondi est un objet mythique de
l'horlogerie et de l'astronomie médiévales. Construite à
Padoue entre 1365 et 1380, cette horloge planétaire indique
l'heure du jour et la position dans le ciel de la Lune, du
Soleil et des cinq planètes visibles à l'il nu.
Véritable représentation mécanique du ciel, l'astrarium
met en mouvement les sept astres errants selon les principes
de Ptolémée, plaçant la Terre au centre de
l'Univers. Conformément à la vision géocentrique du
cosmos, l'astrarium montre des mouvements apparents de ce que
l'on peut voir dans le ciel, grâce à la combinaison des
modèles ptoléméens et à l'ingénieuse conception mécanique de
Dondi.
L'astrarium semble n'avoir jamais bien fonctionné et
disparaît au XVIe siècle. Cependant, le manuscrit de sa
fabrication, un document unique en son genre,
nous est parvenu. Il est à l'origine de l'entreprise de
reconstitution menée à l'Observatoire de Paris entre 1987 et
1989, qui a donné naissance à la réplique
aujourd'hui exposée.
Fruit de conceptions cosmologiques aujourd'hui
abandonnées, l'astrarium témoigne de l'ambition humaine à
saisir les rouages de l'univers et de l'ingéniosité à en
donner une traduction mécanique.
À quoi servait l'astrarium ?
L'astrarìum servait à faciliter l'établissement
d'horoscopes. L'horoscope est un document qui fournit l'état
du ciel à un instant donné pour un certain lieu. Les
astrologues en tirent alors des prédictions. L'établissement
des premiers horoscopes remonte à l'Antiquité.
Si calculer la position du Soleil et des étoiles est
relativement simple, en revanche, déterminer la position des
planètes et de la Lune dans les signes du zodiaque demande
des calculs plus complexes, réalisés à partir de tables
astronomiques. En mécanisant pour la première fois le
mouvement des astres errants, l'astrarium permet de
lire directement leur position, faisant ainsi gagner
un temps considérable aux astrologues. Ces derniers
peuvent ainsi plus facilement déterminer les
circonstances favorables à une initiative.
|